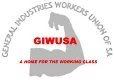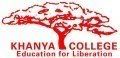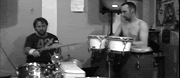Afrique du sud, 13 février 2007
Afrique du sud, 13 février 2007Il fait beau sur Eikenhof. Un soleil de plomb rougit la peau dès l’exposition. Nous sommes trois dans une voiture: moi, Hector et Osborne. Nous représentons l’Union des travailleurs. J’ai apporté mon caméscope et mon appareil-photo numérique. À l’intersection de la Msg Nd Road, une meute de femmes nous attendent. Elles chantent et tapent des pieds; certaines brandissent des affiches, d’autres soufflent dans des trompettes de plastique. Leurs vêtements blanc pourpre jaune bleu rouge vert brun mordoré, dansent et forment des contrastes avec le paysage. Lorsqu’elles nous aperçoivent, leur chant devient cri. L’accueil est intimidant; d’abord parce que je suis blanc comme neige et ensuite, parce j’ignore quelle est la raison de ma présence. Je sors de l’automobile et prépare mon matériel à la demande d’Osborne : micro, caméra, cassette, batterie. Les femmes arrivent en trombe et nous entourent, sifflant et tapant des mains au rythme de la musique endiablée; j’appuie sur le bouton afin de mettre en marche ma caméra.
Devant l’entrée de la Dürsots Industries, des femmes noires manifestent. Elles ont été congédiées par leur employeur sans préavis la journée d’avant. Ces femmes sont des travailleuses illégales; elles immigrent du Mozambique, du Kenya, du Botswana – et d’autres pays d’Afrique – espérant trouver, ici, en Afrique du Sud, une possibilité de vie meilleure. Malheureusement, ces femmes deviennent une main-d’œuvre soumise à un demi-esclavage : elles travaillent pour un salaire hebdomadaire de 165 rans par semaine, ce qui équivaut à un peu plus de vingt-cinq dollars. Cent dollars par mois. Mille deux cent dollars par année. Les heures travaillées ne comptent pas; elles arrivent tôt, à 7h30, avant les employés légaux. Leur quart de travail se termine en pleine nuit, vers quatre heures. Toute la semaine. Près de vingt heures par jour à fabriquer de l’huile, du savon et autres produits manufacturés.
Elles ont des enfants; elles sont majoritairement monoparentales. Elles habitent des bidonvilles ou des Townships, doivent marcher parfois trois ou quatre kilomètres pour se rendre à l’usine. Mais malgré tout, elles chantent, elles rient. Je n’ai jamais vu d’aussi belles femmes. Grosses, maigres, les seins pendants; des sourires où manquent une dent, parfois plusieurs, les cheveux grisés et raidis par le manque d’hygiène. Elles transpirent la vitalité, une soif de vivre hors du commun. Forte, énergique, resplendissante dans la souffrance. Elles ragent devant l’injustice. Leur injustice. Leurs yeux sont remplis de hargne. Elles dansent encore et encore, se défoulent durant de longues minutes avant de s’asseoir sur le sol. Osborne leur parle de l’action qu’ils vont entreprendre. Il me présente, raconte un blabla un peu trop prétentieux pour mes oreilles : je suis un spécialiste de-ci de-ça venant du Canada. Elles sont ravies. Moi, je filme, je prends des photos. J’ai même l’audace de m’asseoir au milieu du cercle. Je les contemple. Je suis fasciné.
Le grillage s’ouvre et une voiture blanche entre dans l’enceinte. Les femmes se précipitent à l’intérieur. Osborne et Hector jubilent. Je veux entrer, mais Osborne m’en empêche; cette occupation est, tout comme ces femmes, illégale. Le garde de sécurité semble médusé. Je reste derrière les barreaux. Nous attendons. Un homme vient à notre rencontre. Puis d’autres lui succèdent. Une masse trapue arrive. Chef-adjoint à la sécurité. Un mètre quatre-vingt-cinq. Yeux bleus bridés. Grandes oreilles rondes. Il parle d’une voix sourde. Osborne et Hector répondent. Je le fixe avec ma caméra. Je focalise sur lui. Je suis un instrument d’intimidation.
Plusieurs hommes sortent des bureaux ; deux gros arabes aux tempes grisonnantes qui se ressemblent; un vieil Arabe avec une longue robe blanche qui floue le sol. Il crie « What’s happening! » trois ou quatre fois à travers sa barbichette grise. Une voiture de police apparaît. Je filme. Je prends des photos en rafale – l’ai-je déjà dit? Pas pour longtemps. Nous avons la permission de rejoindre la direction devant le bâtiment administratif et de parlementer avec eux. Je dois arrêter de filmer.
Trois longues heures s’écoulent sans caméra. J’ai tout de même glissé en douce mon appareil-photo numérique dans la poche de mon pantalon. Je prends quelques photos. Hector et Osborne parlementent avec l’un des gros Arabes borné qui a, disons-le, un sens de la réparti assez inégal. Il prétend que ces femmes n’ont pas le droit de faire cette intrusion, qu’elles marchent sur le sol d’une propriété privée. Osborne le contredit en affirmant que c’est eux qui contreviennent à la loi en congédiant ces travailleuses. L’Arabe me lance des regards furtifs; il s’approche du chef-adjoint à la sécurité et lui ordonne de me surveiller. Le gardien, comme un chien, s’exécute. Il a une matraque dans la main droite. Il joue avec elle, la caresse, tapote sa main gauche avec l’arme. Un homme blanc sort de l’édifice patronale. Près de la cinquantaine. Carré. Chemise blanche. Pantalon noir. Cheveux qui descendent au milieu du front. Lèvres très minces. Nez proéminent, gonflé par le temps. Oreilles longues et pointues. L’homme est une caricature. Il porte un jonc doré à l’auriculaire droit. Une Rolex noire au poignet gauche. Mon oeil fixe la montre. J’imagine les paroles d’un présentateur d’un grand jeu télévisé : « Une montre d’une valeur de plus de dix mille dollars! ». Je ne suis pas fort en calcul mathématique. Mais cette montre, à elle seule, représente dix ans de salaire pour l’une de ces travailleuses.
La police quitte les lieux. Les négociations s’intensifient. La sécurité aussi. Trois camions bondés de gardes. Ils vont utiliser la force si nécessaire. Le chef de la sécurité, un homme maigre avec des yeux de dorade et le profil d’une hyène, menace d’expulser les femmes. Je ne filme plus. Tous regardent au sol. Sauf moi. Je suis un spectateur. Je prends maintenant des notes. La Rolex. Les gardes. Le vieil Arabe. Ses deux fils aux tempes grisonnantes. Les femmes au loin qui chantent. La tension s’élève. Elle est palpable; on pourrait presque la goûter avec les doigts. Des cellulaires sonnent toutes les trois minutes. L’homme-caricature marche avec son téléphone à l’oreille. Sa stature est impressionnante. Il dégage l’autorité.
Les heures s’écoulent. L’intensité du soleil diminue. La peau de mon visage brûle. Osborne et Hector parlementent avec les gardes et les Arabes. Le ton est moins grave, l’argumentation plus diplomate. L’homme-caricature, harassé, tend un document signé à Osborne. Les femmes obtiennent une garantie du paiement de leurs journées de travail jusqu’à la prochaine rencontre avec les délégués syndicaux.
Elles repartent comme elles sont venues; en chantant et en criant, en brandissant haut le poing, signe d’une petite victoire morale et financière. Elles sont encore plus belles qu’au début de la journée.
---------------------------------------------------------------------------------------------
J'ai été à Sonderwater (le nom signifie sans eau en Afrikaner), un bidonville. J'ai presque pleuré. Je vous en reparle dans le prochain mémo...
Libellés : Afrique du sud
0 Comments:
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)